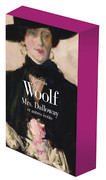La Pléaide
Recherche rapide
Le Cercle de la Pléiade
- La Pléiade /
- La vie de la Pléiade /
- Les coulisses de la Pléiade /
- Les femmes, la fiction et Virginia Woolf
À la une


-
Nouveauté
Collectif
Historiens romains Historiens de la République I, II Coffret deux volumesParution le 26 Septembre 2024
En savoir plus
130.00 €
-
L'actualité de la Pléiade
Les femmes, la fiction et Virginia Woolf La lettre de la Pléiade n° 75, Novembre 2024En savoir plus
Les femmes, la fiction et Virginia Woolf
La lettre de la Pléiade n° 75Novembre 2024
À l’occasion du centième anniversaire de la publication de Mrs. Dalloway, la Pléiade proposera, en février prochain, un « Tirage spécial » dans lequel ce roman et les nouvelles qui lui sont liées voisineront avec Orlando et avec un essai célèbre mais inédit dans la collection, A Room of One’s Own, qui sera publié dans la traduction tout aussi inédite de Laurent Bury, Une pièce à soi. On en propose ici les premières pages.
Mais, pourriez-vous dire, le sujet que nous vous avons demandé de traiter, c’est « Les Femmes et la Fiction » ; quel rapport avec une pièce à soi ? Je vais tenter de m’expliquer. Quand vous m’avez demandé de parler des femmes et de la fiction, je me suis assise au bord d’une rivière pour réfléchir au sens de ces mots. Ils pouvaient renvoyer à quelques remarques sur Fanny Burney, à quelques autres sur Jane Austen, à un hommage aux Brontë et à une esquisse du presbytère de Haworth sous la neige, à quelques traits d’esprit si possible au sujet de Miss Mitford, à une allusion respectueuse à George Eliot, à une référence à Mrs. Gaskell, et le tour était joué. Pourtant, à la réflexion, la formule n’était pas aussi simple. Le titre « Les Femmes et la Fiction » pouvait renvoyer aux femmes et à ce qu’elles sont, et vous auriez pu avoir ce sens-là en tête ; il pouvait aussi désigner les femmes et la fiction qu’elles écrivent, ou encore les femmes et la fiction qu’on écrit à leur propos. Ce titre pourrait aussi indiquer que, d’une certaine façon, ces trois aspects sont inextricablement mêlés et que vous comptez sur moi pour les envisager sous cet angle. Mais quand j’ai commencé à réfléchir au sujet de ce point de vue, qui me semblait le plus intéressant, j’ai bientôt pris conscience d’un inconvénient majeur. Jamais je ne pourrais parvenir à une conclusion. Jamais je ne pourrais m’acquitter de ce qui est, je le comprends, le devoir premier d’un conférencier : vous livrer, au bout d’une heure de discours, une pépite de pure vérité à emballer dans les pages de vos cahiers et à conserver pour toujours sur la cheminée. Tout ce que je pouvais faire, c’était de vous présenter une opinion sur un point mineur : pour écrire de la fiction, une femme doit avoir de l’argent et une pièce à elle. Comme vous le verrez, cela ne résout pas le grand problème de la vraie nature de la femme et de la vraie nature de la fiction. Me dérobant à mon devoir, j’ai renoncé à aboutir à une conclusion sur ces deux questions et, en ce qui me concerne, les femmes et la fiction restent des problèmes non résolus. Mais afin de me faire un peu pardonner, je vais tâcher de mon mieux de vous montrer comment j’en suis arrivée à cette opinion quant à la pièce et à l’argent. Je vais, en votre présence, développer aussi pleinement et librement que possible le fil de la pensée qui m’a menée jusque-là. Si j’expose les idées, les préjugés qui se cachent derrière cette affirmation, vous découvrirez peut-être qu’ils ont quelque rapport avec les femmes et avec la fiction. En tout cas, quand un sujet prête autant à la controverse — et c’est le cas de toute question portant sur le sexe —, on ne peut espérer énoncer la vérité. On peut seulement montrer comment on en est arrivé à avoir l’opinion que l’on a, quelle qu’elle soit. On peut seulement offrir à son auditoire l’occasion de formuler ses propres conclusions face aux limites, aux préjugés et aux idiosyncrasies de l’orateur. La fiction est ici susceptible de contenir plus de vérité que de faits. Je me propose donc, en profitant de toutes les libertés et licences accordées au romancier, de raconter l’histoire des deux journées qui ont précédé ma venue ici — comment, ployant sous le fardeau du sujet que vous aviez posé sur mes épaules, je l’ai soupesé et fait circuler à l’intérieur de mon quotidien. Inutile de le préciser, ce que je suis sur le point de décrire n’a aucune réalité ; Oxbridge est une invention, tout comme Fernham ; « je » n’est qu’un terme commode pour une personne qui n’a pas d’existence réelle. Les mensonges couleront de mes lèvres, mais un peu de vérité y sera peut-être mêlé ; à vous de la chercher, cette vérité, et de décider si une partie vaut la peine d’en être conservée. Dans le cas contraire, vous jetterez le tout dans la corbeille à papier et vous l’oublierez, bien sûr.
J’étais donc (appelez-moi Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael ou comme vous voudrez, c’est sans importance) assise au bord d’une rivière, il y a une semaine ou deux, par un beau temps d’octobre, perdue dans mes pensées. Ce carcan dont j’ai parlé, « Les Femmes et la Fiction », la nécessité de parvenir à une conclusion sur un sujet qui éveille toutes sortes de préjugés et de passions, me faisait baisser la tête vers le sol. À droite et à gauche, des sortes de buissons, écarlate et or, avaient la couleur des flammes et semblaient même en avoir la chaleur. Sur la rive opposée, les saules pleuraient en une lamentation perpétuelle, les cheveux sur les épaules. Du ciel, du pont et de l’arbre en feu, la rivière reflétait ce qu’elle voulait, et quand l’étudiant eut fendu ces reflets de ses avirons, ils se reformèrent, complètement, comme s’il n’avait jamais existé. J’aurais pu rester là une heure, perdue dans mes pensées. Mes réflexions, pour les appeler d’un nom plus glorieux qu’elles ne le méritaient, avaient jeté leur ligne dans le cours d’eau. À chaque instant, elle se balançait ici et là, parmi les reflets et les herbes, tantôt soulevée par le courant, tantôt entraînée par le fond, jusqu’à ce que la soudaine agglomération d’une pensée tire le bout d’une ligne : vous connaissez cette petite secousse, après quoi il faut mouliner avec précaution, et décrocher soigneusement sa prise ? Hélas, étalée sur l’herbe, comme ma pensée semblait petite et insignifiante : le genre de poisson qu’un bon pêcheur rejette à l’eau pour qu’il engraisse et vaille un jour la peine d’être cuisiné et mangé. Je ne vous dérangerai pas maintenant avec cette pensée, même si, avec un peu d’attention, vous la découvrirez peut-être par vous-mêmes dans le cours de ce que je vais dire.
Cependant, si petite qu’elle fût, elle n’en avait pas moins cette mystérieuse qualité de son espèce : une fois remise dans l’esprit, elle devint aussitôt tout à fait enthousiasmante et importante ; tout en filant et sombrant, elle projetait des éclats un peu partout, suscitant un tel déferlement, un tel tumulte d’idées qu’il était impossible de rester immobile. Voilà comment je me suis surprise à marcher à une vitesse extrême à travers une étendue herbeuse. Aussitôt une silhouette d’homme s’est dressée pour m’intercepter. Et tout d’abord je n’ai pas compris que c’était à moi que s’adressaient les gesticulations d’un objet d’aspect curieux, arborant queue-de-pie et chemise à plastron. Son visage exprimait l’horreur et l’indignation. L’instinct vint à mon secours, plutôt que la raison ; c’était un huissier, j’étais une femme. Le gazon se trouvait ici, le chemin, là. Seuls les enseignants et les étudiants étaient admis sur ce gazon ; c’est sur le gravier que j’aurais dû marcher. Ces pensées me vinrent en un instant. Alors que je repartais sur le chemin, les bras de l’huissier retombèrent, son visage reprit son calme ordinaire, et bien qu’il soit plus agréable de marcher sur le gazon que sur le gravier, il n’y avait pas grand mal à cela. Mon seul grief contre les enseignants et les étudiants, quel qu’ait pu être le college en question, était que, pour protéger leur pelouse, entretenue depuis trois siècles, ils avaient fait fuir mon petit poisson.
J’étais incapable de me rappeler à présent quelle idée m’avait inspiré l’audace de marcher là où je n’en avais pas le droit. L’esprit de la paix descendit des cieux comme un nuage, car si l’esprit de la paix réside quelque part, c’est bien dans les cours et les cloîtres d’Oxbridge, un beau matin d’octobre. Alors que je parcourais ces colleges et longeais ces antiques bâtiments, la brutalité du présent paraissait évacuée ; le corps semblait contenu dans une miraculeuse armoire vitrée à travers laquelle aucun son ne pouvait pénétrer, et l’esprit, libéré de tout contact avec les faits (à moins d’empiéter de nouveau sur le gazon), avait tout loisir d’opter pour la méditation qui s’harmonisait avec le moment. Le hasard voulut que le souvenir égaré d’un vieil essai sur un retour à Oxbridge durant les grandes vacances me fît songer à Charles Lamb — saint Charles, disait Thackeray, appliquant contre son front une lettre écrite par Lamb. De fait, parmi tous les morts (je vous livre mes pensées telles qu’elles me venaient), Lamb est l’un des plus sympathiques, l’un de ceux à qui l’on aimerait dire : Expliquez-moi donc comment vous avez écrit vos essais. Car ses essais sont même supérieurs à ceux de Max Beerbohm, malgré toute leur perfection, pensai-je, grâce à ce farouche éclair de l’imagination, ce claquement de tonnerre du génie qui, en leur milieu, les rend défectueux et imparfaits, mais étoilés de poésie. Lamb, donc, vint à Oxbridge il y a peut-être une centaine d’années. Il rédigea certainement un essai, dont le titre m’échappe, sur le manuscrit d’un poème de Milton qu’il y admira. C’était peut-être « Lycidas », et Lamb nota qu’il avait été choqué à l’idée qu’un seul mot de « Lycidas » avait pu être différent de ce qu’il était. Imaginer Milton modifiant les mots de ce poème lui semblait une sorte de sacrilège. Cela me conduisit à tâcher de me ressouvenir de « Lycidas » et à m’amuser à deviner quel mot Milton avait pu modifier, et pourquoi. Je songeai alors que le manuscrit même que Lamb avait regardé ne se trouvait qu’à quelques centaines de mètres, de sorte qu’il était possible de suivre les pas de Lamb à travers la cour de cette illustre bibliothèque où repose le trésor. De plus, me souvins-je, alors que je mettais ce projet à exécution, c’est dans cette illustre bibliothèque qu’est conservé le manuscrit de l’Esmond de Thackeray. Les critiques disent souvent qu’Esmond est le roman le plus parfait de Thackeray. Mais on est gêné, autant que je me souvienne, par l’affectation de son style, qui imite celui du XVIIIe siècle ; à moins que, en fait, le style du XVIIIe siècle ait été naturel pour Thackeray, ce que l’on pourrait démontrer en examinant le manuscrit et en vérifiant si les modifications y furent apportées dans l’intérêt du style ou bien du sens. Mais il faudrait alors décider ce qu’est le style et ce qu’est le sens, question qui… mais le fait est que je me trouvais face à la porte qui donne accès à la bibliothèque proprement dite. Je dois l’avoir ouverte, car en est aussitôt sorti, comme un ange gardien barrant la route en agitant sa toge noire plutôt que ses ailes blanches, un monsieur argenté, aimable et désapprobateur, qui regrettait à voix basse, tout en me faisant signe de reculer, que les dames ne soient admises dans la bibliothèque qu’accompagnées d’un membre du corps enseignant ou munies d’une lettre de recommandation.
Qu’une illustre bibliothèque ait été maudite par une femme, voilà qui laisse parfaitement indifférente l’illustre bibliothèque. Vénérable et calme, ses trésors bien à l’abri en son sein, elle dort en toute satisfaction et, si cela ne dépend que de moi, dormira toujours ainsi. Jamais je ne réveillerai ces échos, jamais je ne redemanderai cette hospitalité, je l’ai juré alors que je descendais les marches avec colère. Il restait encore une heure avant le déjeuner, que pouvais-je faire ? Me promener dans les prés ? M’asseoir au bord de la rivière ? C’était assurément une belle matinée d’automne, les feuilles rouges tombaient à terre en voletant, et les deux possibilités qui s’offraient à moi n’avaient rien de bien déplaisant. Mais de la musique atteignit mon oreille. Une messe, une commémoration était en cours. L’orgue émettait sa plainte magnifique lorsque je passai devant la porte de la chapelle. Dans cet air serein, même la tristesse du christianisme sonnait moins comme un chagrin que comme le souvenir d’un chagrin ; même les gémissements de l’orgue antique semblaient enveloppés de paix. Je n’avais aucune envie d’entrer, que j’en aie ou non le droit, et cette fois le bedeau aurait pu m’arrêter, exiger peut-être mon certificat de baptême, ou une lettre de recommandation émanant du doyen. Mais l’extérieur de ces splendides édifices est souvent aussi beau que l’intérieur. De plus, il était assez amusant d’observer les fidèles qui se rassemblaient, pénétraient et ressortaient, s’affairant à la porte de la chapelle comme des abeilles à l’entrée d’une ruche. Beaucoup portaient la toge et le bonnet carré ; quelques-uns avaient des touffes de fourrure sur les épaules ; d’autres étaient véhiculés en fauteuil roulant ; d’autres encore, bien que n’ayant pas dépassé l’âge mûr, semblaient froissés et broyés en des formes si singulières qu’elles évoquaient ces crabes et écrevisses géants qui se traînent avec difficulté sur le sable d’un aquarium. Alors que j’étais adossée au mur, l’université m’avait tout l’air d’un sanctuaire où sont préservées des créatures rares qui seraient bientôt vouées à l’extinction si on les laissait lutter pour leur survie sur les trottoirs du Strand. De vieilles histoires de vieux doyens et de vieux professeurs me revenaient à l’esprit, mais avant que j’aie trouvé le courage de siffler — on prétendait jadis qu’au son d’un sifflet le vieux Professeur détalait aussitôt — les vénérables ouailles étaient entrées. Restait l’extérieur de la chapelle. Comme vous le savez, ses pinacles et ses dômes élevés, comme un vaisseau naviguant à jamais, sont éclairés la nuit et visibles à des kilomètres à la ronde, au-delà des collines. Autrefois, on peut le supposer, cette cour rectangulaire aux pelouses lisses, ses bâtiments massifs et la chapelle même n’étaient tous que marécages, où les herbes oscillaient et où les porcs fouissaient. Des attelages de chevaux et de bœufs, pensai-je, avaient dû apporter la pierre par charretées depuis des comtés lointains, puis, avec des peines infinies, les blocs gris à l’ombre desquels je me tenais à présent furent empilés en ordre les uns sur les autres, puis les peintres apportèrent leur verre pour les fenêtres, et les maçons s’activèrent pendant des siècles sur ce toit avec de l’enduit et du ciment, des pelles et des truelles. Tous les samedis, quelqu’un devait venir verser l’or et l’argent d’une bourse de cuir dans leurs poings antiques, car le soir, probablement, ils buvaient de la bière et jouaient aux quilles. Un flux incessant d’or et d’argent, pensai-je, avait dû perpétuellement animer cette cour pour que les pierres continuent à arriver et les maçons à travailler ; pour aplanir, excaver, creuser et drainer. Mais c’était alors l’ère de la foi, et l’argent fut dépensé sans compter pour poser ces pierres sur de profondes fondations, et quand ces murs se levèrent, plus d’argent encore fut puisé dans le trésor des rois, des reines et de la haute noblesse, pour s’assurer que l’on chanterait ici des cantiques et que l’on instruirait des étudiants. Des terres furent concédées, des dîmes furent payées. Et quand l’ère de la foi eut pris fin et que vint l’ère de la raison, le même flux d’or et d’argent se poursuivit ; des bourses furent créées, des chaires furent dotées ; simplement, désormais, l’or et l’argent ne coulaient plus des coffres du roi, mais de ceux des marchands et des manufacturiers, de la bourse d’hommes qui avaient fait fortune dans l’industrie, par exemple, et en avaient, par testament, alloué une part généreuse au financement d’autres postes, d’autres chaires, d’autres bourses dans l’université où ils avaient appris leur métier. D’où les bibliothèques et les laboratoires, les observatoires, le superbe équipement composé d’instruments fragiles et coûteux, aujourd’hui présenté sur des étagères de verre, là où, des siècles auparavant, les herbes oscillaient et les porcs fouissaient. Certes, alors que je faisais le tour de cette cour, les fondations d’or et d’argent semblaient assez profondes, le dallage était solidement posé sur les herbes folles. Des hommes portant des plateaux sur la tête s’activaient d’un escalier à l’autre. Des fleurs aux vives couleurs s’épanouissaient dans les jardinières des fenêtres. Les accents du phonographe jaillissaient des chambres. Il était impossible de ne pas réfléchir — la réflexion, quelle qu’elle ait pu être, fut interrompue. L’horloge sonna. Il était temps d’aller déjeuner.
Fait curieux, les romanciers ont l’art de nous faire croire que les déjeuners sont invariablement mémorables parce qu’il s’y est dit quelque chose de très spirituel, ou qu’il s’y est fait quelque chose de très sage. Mais ils prennent rarement la peine de préciser ce que l’on y a mangé. Par convention, le romancier ne doit pas mentionner la soupe, le saumon ou les canetons, comme si la soupe, le saumon et les canetons étaient absolument sans importance, comme si jamais personne ne fumait de cigare ou ne buvait de verre de vin. Ici, pourtant, je prendrai la liberté de braver cette convention et de vous dire que le déjeuner, en cette occasion, commença par des soles, enfoncées dans un plat profond, sur lesquelles le cuisinier du college avait répandu une courtepointe de la crème la plus blanche, à cela près qu’elle était marquée ici et là de points bruns comme les taches sur les flancs d’une biche. Vinrent ensuite les perdrix, mais si ce mot vous évoque deux ou trois oiseaux bruns et chauves sur une assiette, vous vous trompez. Les perdrix, nombreuses et variées, étaient accompagnées de tout leur cortège de sauces et de salades, tour à tour piquantes ou douces ; de leurs pommes de terre, minces comme des pièces de monnaie mais bien moins dures ; de leurs choux de Bruxelles, plissés comme des boutons de rose mais plus succulents. Et à peine en avait-on terminé avec le rôti et son entourage que le serviteur silencieux, peut-être l’huissier en personne sous une forme moins véhémente, plaça devant nous, emmitouflée de serviettes, une construction tout en sucre surgie de l’onde. La qualifier de pudding et l’apparenter ainsi au riz et au tapioca serait une insulte. Pendant ce temps, les verres à vin s’étaient teintés de jaune et teintés d’écarlate ; avaient été vidés ; avaient été remplis. Ainsi, par degrés, s’alluma en un point au milieu de la colonne vertébrale, qui est le siège de l’âme, non cette petite lumière électrique et dure qu’on appelle « bel esprit », lorsqu’elle clignote sur nos lèvres, mais la lueur plus profonde, plus subtile et plus souterraine qu’est la riche flamme dorée du discours rationnel. Nul besoin de se presser. Nul besoin d’étinceler. Nul besoin d’être un autre que soi. Nous allons tous au ciel, et Van Dyck est de la compagnie — autrement dit, comme la vie semblait belle, comme ses récompenses étaient douces, comme paraissait futile tel grief ou telle rancœur, comme étaient admirables l’amitié et la société de nos semblables alors que, tout en allumant une bonne cigarette, je m’enfonçais parmi les coussins de la banquette près de la fenêtre.
Si par chance il y avait eu un cendrier à portée de main, s’il n’avait fallu, à défaut, secouer la cendre par la fenêtre, si les choses avaient été un peu différentes de ce qu’elles étaient, je n’aurais probablement pas vu un chat sans queue. Par quelque heureux hasard de l’intelligence subconsciente, l’apparition de cet animal abrupt et tronqué marchant à pattes de velours à travers la cour transforma pour moi l’éclairage émotionnel. Ce fut comme si quelqu’un avait baissé un abat-jour. Peut-être l’emprise de l’excellent vin blanc s’atténuait-elle. Assurément, tandis que je regardais le chat de Man s’arrêter au milieu de la pelouse comme s’il interrogeait lui aussi l’univers, quelque chose semblait manquer, quelque chose semblait différent. Mais que manquait-il, qu’y avait-il de différent, me demandai-je tout en écoutant la conversation ? Pour répondre à cette question, je dus me transporter par la pensée hors de la pièce, faire retour dans le passé, avant la guerre, et placer sous mes yeux le modèle d’un autre déjeuner, donné dans un lieu pas très éloigné de celui-ci, mais différent. Tout était différent. Pendant ce temps, la conversation se poursuivait entre les convives, qui étaient nombreux et jeunes, et des deux sexes ; elle se poursuivait sans heurts, elle se poursuivait de manière agréable, libre, amusante. Et tandis qu’elle se poursuivait, je la comparai à celle du passé, et en les rapprochant je n’eus aucun doute : l’une était la descendante, l’héritière légitime de l’autre. Rien n’avait changé, rien n’était différent sauf — tout ouïe, je me mis alors à écouter non pas tant ce qui se disait, mais le murmure, le courant qui circulait par-derrière. Oui, c’était cela, le changement résidait là. Avant la guerre, lors d’un déjeuner comme celui-ci, les gens auraient dit exactement les mêmes choses, mais leurs propos auraient sonné autrement, parce qu’en ce temps-là, ils s’accompagnaient d’une sorte de bourdonnement, non pas articulé mais musical, enthousiasmant, qui modifiait la valeur des mots mêmes. Pouvait-on transcrire ce bourdonnement en mots ? Avec l’aide des poètes, on le pouvait peut-être. […]
Traduit de l'anglais par Laurent Bury.
Auteur(s) associé(s)



 Agrandir
Agrandir Diminuer
Diminuer